Chaque mois, découvrez ici la bande-son d’ADHF, une sélection de vinyles parmi les meilleures sorties du moment.
Retenues pour leur qualité d’enregistrement, leur rareté ou la créativité de leurs auteurs, les musiques choisies par ADHF abordent tous les genres ; elles vous permettront de constituer, au fil des mois, une discothèque originale, à la hauteur de votre installation.
De quoi régaler les meilleures platines vinyles du marché !
O C T O B R E 2 0 1 8
BLANCMANGE
Wanderlust
Blanc Check, 2018

Résurrection. Parmi les groupes classieux de de la synthpop (sainte pop ?) du début des années quatre-vingt, Blancmange occupait une place à part : plus inventif, plus romantique, plus noir aussi que les garçons-coiffeurs avec lesquels on a un moment confondu les gueules dépareillées de Stephen Luscombe (le petit chauve) et de Neil Arthur (le grand frisé). Quoi qu’il en soit, tout nightcluber encore en possession de quelques neurones doit quelque chose (ou quelqu’un) à Waves, sur leur premier album (Happy Families, 1982) – qui réintroduisit le slow au Palace – et à Blindvision, sur Mangetout (1984) – qu’Ibiza se réappropria dix ans après sa sortie. Après une longue absence – qui, pour être franc, aura plutôt marqué une longue négligence de notre part, quand on sait qu’après les ennuis de santé de Luscombe, Neil Arthur avait repris le flambeau, produisant quatre albums en solo entre 2011 et aujourd’hui – Blancmange nous revient avec un disque magique, habité et hautement addictif. Le tournant résolument électro amorcé avec Believe You Me (1986) est ici magnifié par les machines de Benge, qui, au fil de ses nombreuses collaborations (John Foxx, Tuung) se révèle comme le véritable successeur de Brian Eno en matière de sorcellerie numérique. Propulsées par des mélodies entêtantes et servies par le chant de Neil Arthur – moins mâle, moins « angry young man » mais plus émotif que par le passé –, Not a Priority, I Smashed Your Phone et Distant Storm, aux lyrics pince-sans-rire, deviennent de véritables machines à danser. Entre les rééditions de Stéréolab (trois albums indispensables chez Duophonic UHF Disks), de Yazoo (Mute) et de Soft Cell (UMC), on ne manquera pas ce mois-ci d’occasions de célébrer l’éclaircie électronique qui mit définitivement à la retraite les relous du disco. Wanderlust n’ajoutera rien au plaisir du souvenir : la nouvelle recette de Blancmange s’adresse bien aux oreilles d’aujourd’hui, qui y trouveront ce qui manque aux derniers Depeche Mode et New Order pour être tout à fait contemporains.
LOW
Double Negative
Sub-Pop, 2018

Révélation # 11. Combien de temps, combien d’albums faudra-t-il pour que Low soit considéré comme l’un des plus grands groupes du monde en activité ? Après avoir ralenti le slowdive jusqu’à l’absence de mouvement (I Could Live in Hope, 1994), approché l’essence de la pop en éradiquant un à un tous ses ornements (Secret Name, 1999), appliqué son régime amaigrissant à nos hits les plus chers (Little Drummer Boy, Transmission de Joy Division, I Started a Joke des Bee Gees), touché au sublime avec Things We Lost in the Past, en 2001 (et un concert parisien heureusement enregistré) le trio de Duluth, cantonné bien malgré lui dans le recoin des cultes jalousement dissimulé par leurs fans, avait pourtant fait un pas vers le grand public. Entre 2005 et 2010 sortirent deux albums, The Great Destroyer et C’mon, don’t la densité et l’urgence n’avaient rien à envier aux shoegazers de l’époque (destructuration cacophonique en plus). Le départ de Zak Sally ne sembla pas affecter le groupe et le couple Alan Sparhawk et Mimi Parker reprit, avec One & Sixes et The Invisible Way, ses anciennes études en no-wave là-où il les avait abandonnées. Au passage, leur frequentation avec Jeff Tweedy (Wilco) et Matt Beckley (le producteur de Katy Perry) leur avait appris les bases du maniement des machines. La caisse claire de Mimi Parker fut de plus en plus souvent confrontée aux pulsations métronimique d’une boîte à rythme, le timbre unique de sa voix dut se battre contre les excès de la reverb et les compositions de Sparhawk durent lutter ferme pour conserver leur humanité, une fois passées au chromage de la post-production. Double Negative pousse cette logique de confrontation entre l’homme et la machine dans ses derniers retranchements. Dès la première plage du disque, la mélodie, à peine reconnaissable, est implacablement rayée, parasitée, griffée par un insupportable scratch qui pourrait vous faire douter des branchements de votre installation. Sans vergogne, et même avec un masochisme certain, Sparhawk et Parker vont ainsi sacrifier la plupart de leurs nouveaux morceaux à l’assaut de la technologie et c’est dans un territoire de guerre que subsisteront, à l’état minéral, les fragments de mélodies sauvées de la destruction. Le message est clair. Aucun groupe, jusqu’ici, n’avait osé l’expérimenter sur sa propre musique. On attend avec impatience la prochaine étape.
DIE WILDE JAGD
Uhrwald Orange
Bureau B, 2018

Si leur premier album ne nous avait pas tout à fait convaincu (manqué d’unité, volonté de trop en dire, péché de jeunesse), le deuxième remporte la mise haut la main. Surtout pour ceux qui ont eu la chance d’assister à la prestation du duo berlinois au dernier Convenanza d’Andrew Weatherall, à Carcasonne. Depuis Alan Vega, il y avait longtemps qu’on n’avait pas vu un groupe d’électro avoir aussi une présence scénique. Il faut en effet avoir vu Stephen Lee Philipp, (long comme un Joe Ramone, lorsqu’il avance une jambe en appui sur un retour) recouvrir de ses noires nappes de guitare les tribales et implacables rythmiques de Thomas Klein pour comprendre à quel point le groupe habite ses morceaux. Sur Der Uhrwald, (V.O. L’Horloge, pour ceux qui n’ont pas pris allemand en première langue) le chant de Philipp n’a rien à envier à la diction détachée de Gary Numan. On pense à DAF, à Kraftwerk, à Bauhaus, aux Breeders et on a tort : la musique de Die Wilde Jagd (V.F. “La Chasse sauvage”) est trop tordue pour copier qui que ce soit. Les quatre faces d’Uhrwald Orange, alternant romances atmosphériques, mantras hypnotiques, hymnes guerriers et délires soniques, laissent au groupe tout le temps d’en faire la démonstration. Dernière barrière à lever pour ceux qui se méfient des lyrics en teuton – c’est toujours dommage de s’apercevoir qu’on vient de pogoter une heure sur des textes fascisants… – pas de crainte à avoir. Vérification faite, l’inspiration du groupe provient plutôt d’étranges contrées et de forêts peuplées de 2000 éléphants, de chevaux sous acide et d’hommes chauve-souris… Les chemises noires de Sebastian sont bien celles de Lord Byron, de Bela Lugosi et de Ian Curtis.
BARRY ADAMSON
Memento Mori
Mute, 2018

Célébration. Le nom doit vous dire quelque chose, mais il y a de grandes chances pour que vous n’identifiiez pas complètement sa trajectoire. Bassiste, chanteur et compositeur, Adamson aura pourtant traversé, en quarante ans de carrière, le meilleur de la production musicale indie. Bon, ça commence moyen avec Visage, dont il quitera rapidement l’ambiance venimeuse, tout en accompagnant le groupe en studio sur ses deux premiers albums. Il s’investira plus complètement aux côtés de ses amis Howard Devoto et Dave Formula, avec lesquels il écrivit le bringuebalant Parade (“Sometimes I forget we’re supposed to be in Love…”), sur Real Life, en 1977, et collabora à la plupart des chansons de Magazine. Après Magic, Murder & the Weather, il travailla un moment avec Pete Shelley, un autre ex-Buzzcocks, avant de rejoindre les Bad Seeds de Nick Cave, où il tiendra la basse sur quatre des plus grands albums de l’Australien. C’est au retour d’une tournée avec Iggy Pop que notre homme, au tournant de sa trentième année, décida d’abandonner sa carrière de sideman pour se mettre à son compte. Les neuf albums qu’il sortira entre 1988 et 2016, d’abord sur Mute Records, puis sur son propre label Central Control International, sont autant de tours de force: musiques composées pour des ballets, des jeux video ou des films imaginaires (Moss Side Story, 1989 ; Oedipus Schmoedipus, 1996), mêlant post-pop, funk, électro, musique industrielle et variations savantes sur les traces de ses héros, Ennio Morricone, Bernard Hermann et John Barry. Memento Mori, l’anthologie dorée sur tranche, cadeau de son ami Daniel Miller pour son soixantième anniversaire, rend justice à l’exceptionnel mélodiste et arrangeur que fut Adamson. Composées principalement de ses compositions personnelles, les quatre faces de ce monument sont riches de découvertes, qui deviendront vite l’indispensable bande-son de cet automne, et même de l’hiver qui s’annonce.
SOLID SPACE
Space Museum
Dark Entries, 2017

Exhumation. En 1973, deux pré-ados passionnés de science-fiction et de la série télévisée Doctor Who, se croisent dans la banlieue de Londres et se débrouillent pour intégrer le collège dans la même classe. A 14 ans, ils montent un groupe, Exhibit A et, dans la foulée, une compagnie de disques, Irrelevant Wombat Records, pour diffuser à leurs copains leurs cassettes audio. Pendant trois ans ils répètent dans le garage de leurs parents, expérimentant les possibilités encore inouïes que leur offrent les premiers synthétiseurs et autres boîtes à rythmes (à piles) dans lesquels ils passent toutes leurs économies. Avec l’aide d’un troisième camarade, ils enregistrent leurs douze chansons les plus abouties sur une cassette et… Ça vous rappelle quelque chose ? Perdu. Non, ce n’est pas l’histoire d’Orchestral Manœuvre in the Dark que je vous raconte là, mais celle de leurs doubles clandestins, Matthew ‘Maf’ Vosburgh et Dan Goldstein au sein de l’éphémère formation Solid Space. Leur album, Space Museum, sortira quelques mois après le premier OMD sans intéresser aucune major de l’édition musicale : la place est déjà prise. Il aura fallu trente-sept ans pour que le label Dark Entries ressorte sous forme de vinyle ce joyau du minimalisme, devenu entretemps l’objet d’un véritable culte. Difficile de dire ce que serait devenu le duo si l’industrie lui avait donné sa chance, car tout était déjà là : Destination Moon, c’est Syd Barrett chantant Space Oddity, A Darkness in my Soul c’est les Cure de Three Cool Cats enregistrés par Alan Vega, Spectrum is Green, Jonathan Richman reprenant un titre des Feelies… Évidemment, à la fin des années soixante-dix, des centaines de cassettes de ce genre ont dû être envoyées aux radios et aux compagnies en place. Solid Space n’en surprend pas moins par son et la qualité de ses compositions.
MEMORIAL DEVICE
David Keenan
Buchet-Chastel, 2018
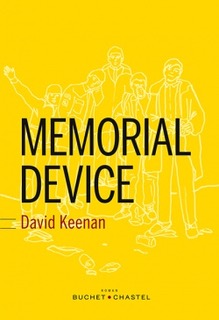
Edition. Une fois n’est pas coutume, on terminera cette sélection par un livre, dont « l’effet drogue » – si, comme Françoise Hardy, c’est ce que vous recherchez en écoutant de la musique – n’est pas moins puissant qu’une face de Joy Division. Dave Keenan est un type pas commun. Un intello, certes, mais aussi un pratiquant, versé dans l’occulte, les tarots et le côté noir de la force. Un musicien, guitariste de 18 Wheeler, qu’il quitta pour fonder Telstar Ponnies, deux légendes de la scène destroy écossaise. Et un journaliste multicarte. De lui, les éditions du Camion blanc ont sorti, en 2016, la bible de la scène underground anglaise, où, sur plus de 550 pages en corps 9, il analysait la musique de Coil, de Curent 93 et autres Nurse With Wound, s’attachant au fil d’interminables interviews à trouver une morale aux délires de David Tibet et une base anthropologique à l’art visionnaire de David Stapleton. Mémorial Device est son premier roman. Ça se passe à Airdrie, un trou du cul de patelin coincé entre les deux fesses grasses de Glasgow et d’Édimbourg, dans les années post punk où « rien n’étant plus possible, tout était possible ». C’est l’histoire d’un petit groupe de jeunes paumés qui y ont cru. Cru à Memorial Device, à ce groupe qui devait faire la première partie de Sonic Youth et les sortir de l’anonymat. C’est écrit à vif, avec un art du dialogue achevé que ne gâche pas la traduction de Nathalie Peronny (qui nous avait déjà servi d’interprète aux mémoires de Mark E. Smith). C’est un témoignage de première main sur la jeunesse, sur une énième génération perdue, qui vous tirera, entre deux souvenirs inavouables, des sanglots de compassion. Car ce n’est pas le moindre mérite du romancier que de savoir tirer d’un éphémère micro-phénomène une vérité valable pour tout le monde. Keenan y réussit avec panache, sur le nerf.
Un article de Mr lB.
